
Intérêt des toiles de jute autour de la mise bas pour réduire le nombre de morts nés
Intérêt des toiles de jute autour de la mise bas pour réduire le nombre de morts nés
Les truies pour lesquelles une toile de jute a été mise en place autour de la mise bas ont significativement moins de morts nés.
L’apport d’un matériau manipulable de nidification aux truies autour de la mise bas a été rendu obligatoire par les nouvelles normes bien-être.
En France, les toiles de jutes ont été plébiscitées. Loin d’être une contrainte, elles permettent à la truie d’exprimer son comportement naturel de constitution du nid. Si ce besoin n’est pas satisfait, il a été démontré une augmentation des marqueurs de stress, accompagnée par une réduction de la concentration en ocytocine, ce qui a un impact négatif sur la durée de la mise bas et la montée en lait.
Beaucoup d’éleveurs ont perçu un bénéfice après la mise en place des toiles de jute en terme de comportement des truies et de réduction du nombre de morts nés. Cette dernière observation est confirmée par une récente étude canadienne publiée dans le Canadian Journal of Animal Sciences.
Les auteurs ont comparé 2 groupes de près de 300 truies, avec ou sans toile de jute. Les truies pour lesquelles une toile de jute a été mise en place autour de la mise bas ont significativement moins de morts nés : le taux de morts nés moyen est réduit de 8,3 % à 6,5 %.









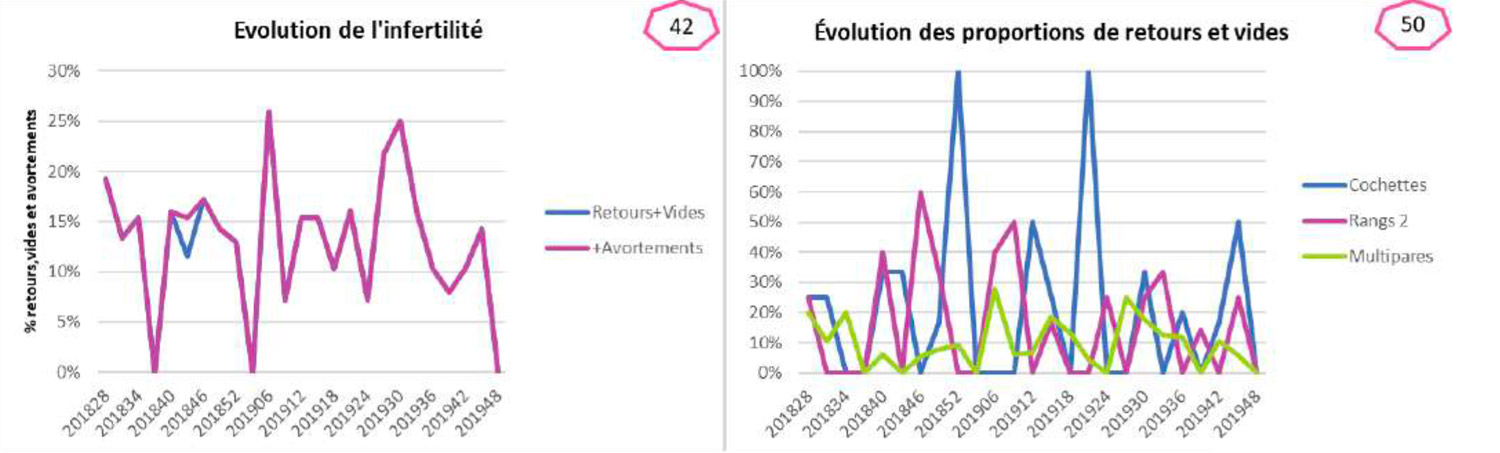
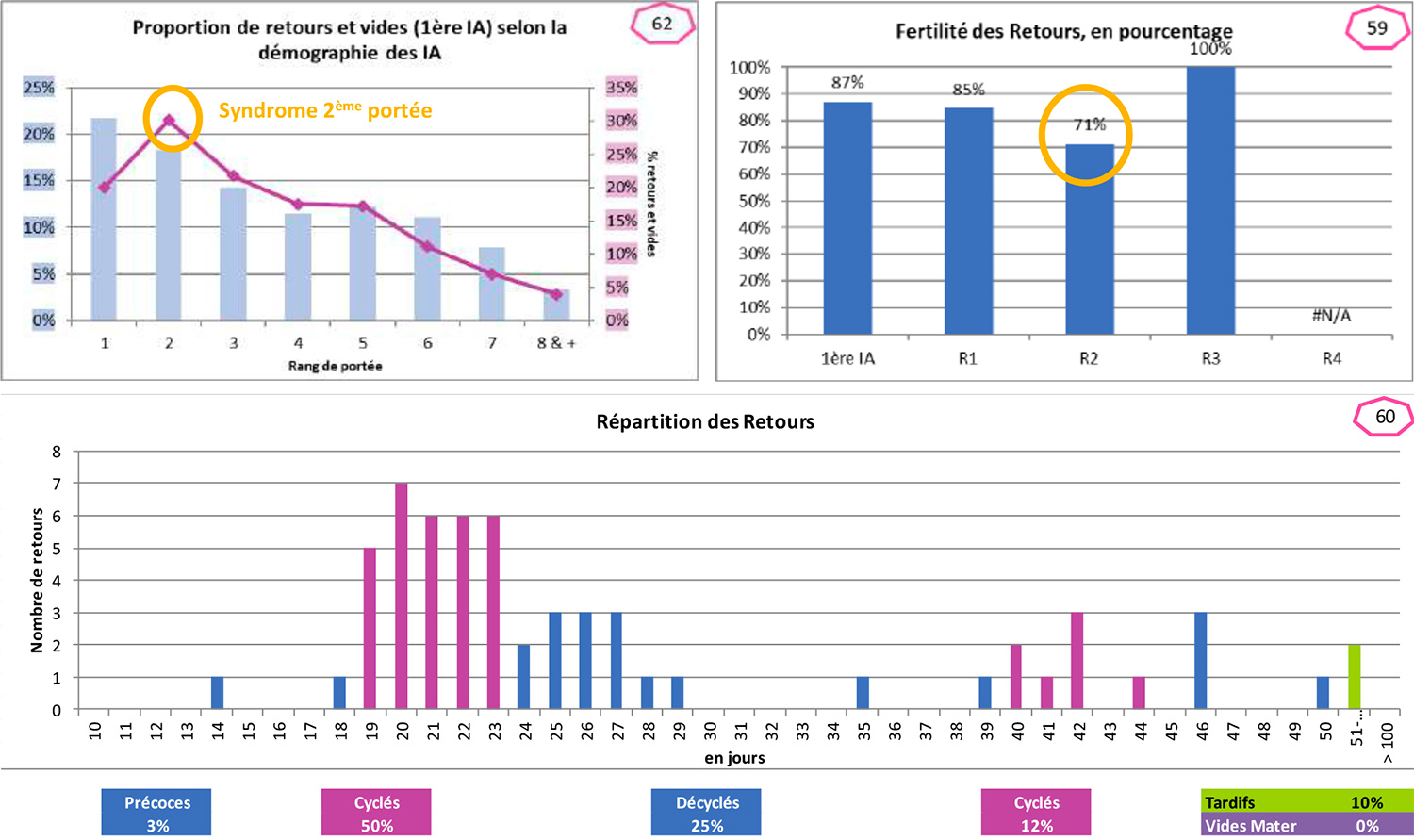
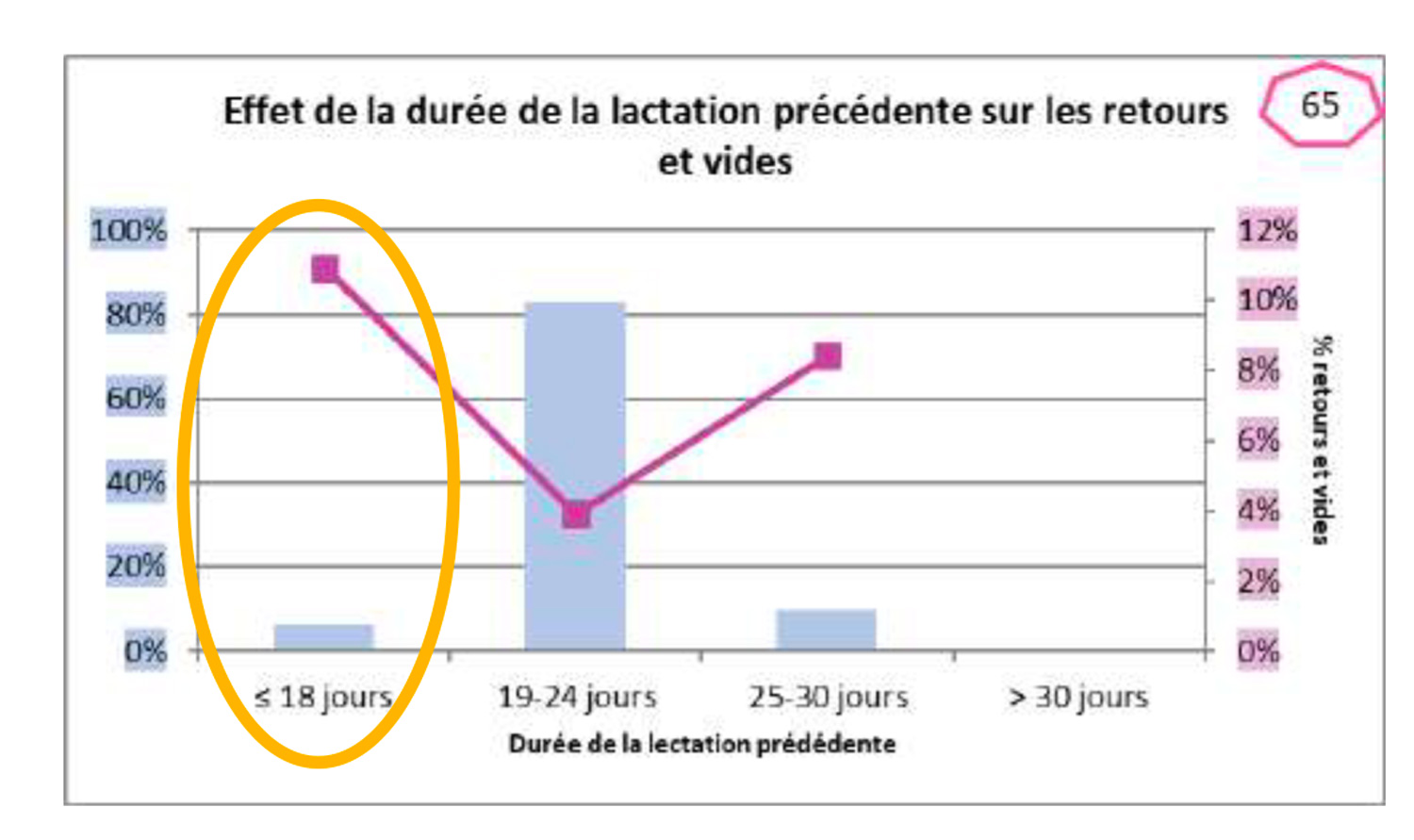
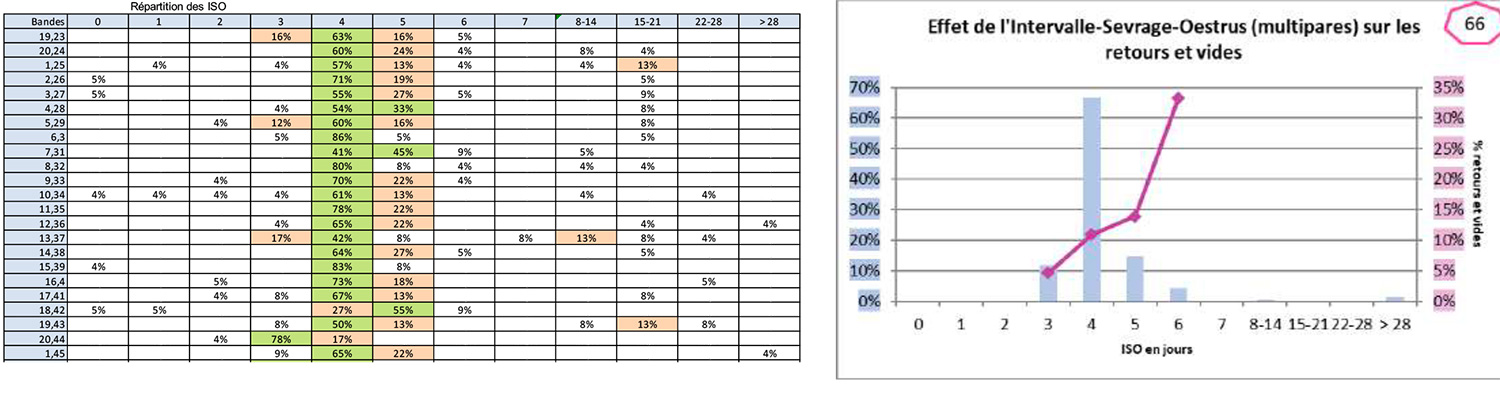













Commentaires récents